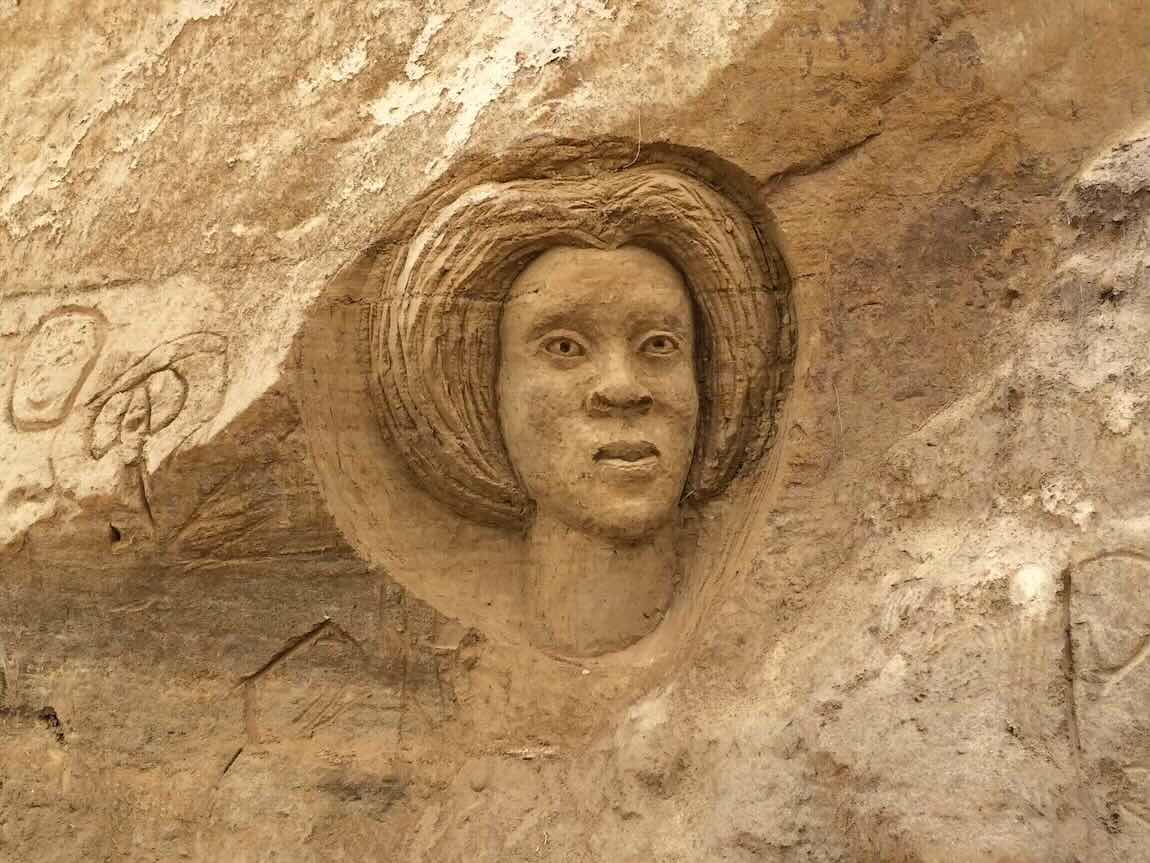Présence de Marguerite Duras
Présence, nom féminin désignant (selon le dictionnaire le Robert) ;
-
Le fait d’être physiquement quelquepart, auprès de quelqu’un
- Le fait de manifester son influence
- Le fait qu’une chose soit dans le lieu où l’on est ou dont on parle
- La qualité consistant à manifester avec force sa personnalité
« J’aimerais qu’on écrive sur moi comme j’écris »
« J’aimerais qu’on écrive sur moi comme moi j’écris », m’avait-elle lancé en avril 1990, de l’autre côté de la table ronde de la salle à manger, rue Saint-Benoît, où j’étais venue l’interviewer pour le Magazine Littéraire. Comme tous ses interlocuteurs, elle cherchait à me tirer vers là où, résolument, elle se tenait. Elle cherchait à m’absorber, à ce que je devienne sienne, un vecteur de ce qu’elle était, de ce qu’elle ressentait, de ses certitudes sur la politique, sur l’amour, et plus que tout sur l’écrit, pour elle point de départ et aboutissement de toute chose. « Elle écrit à la naissance des mots, de l’intelligence, du silence », me disait Yann Andréa en 2006, au présent du verbe écrire, alors qu’elle était morte, et depuis dix ans déjà.
Quand elle m’avait reçue, elle n’avait pas trouvé en moi matière pour un personnage, des bribes qu’elle aurait pu saisir, transformer, sublimer. C’est ce qu’elle traquait dans toute personne qu’elle rencontrait, de la concierge au Président de la République. Un geste, une façon d’être, un type de présence comme ceux caractérisant, à jamais, Anne-Marie Stretter qui avec « son élégance et dans le repos, et dans le mouvement, […] inquiétait » – ou Lol V. Stein : « c’était cette région du sentiment qui, chez Lol, n’était pas pareille ».
Marguerite Duras et l’autobiographie
Mon premier livre était sous presse, il s’intitulait Marguerite Duras et l’autobiographie. Je le lui avais avoué. Elle ne m’avait pas demandé de lui soumettre le manuscrit. Ça ne l’intéressait pas de vérifier. Sa présence suffirait : elle s’imposerait dans mon écriture. Elle croyait au pouvoir de fascination qu’elle exerçait par sa manière d’exiger des réponses aux questions qu’elle posait et aussi par sa forme, si particulière, de séduction à laquelle Bernard Pivot n’avait pas échappé au cours d’un Apostrophes de légende après la sortie de L’Amant. Sa quête, c’était « un livre où il y aurait tout à la fois ». Sa présence, c’était un tout. Elle ne capitulait pas. Même après des mois de coma qui avaient accentué le tassement de son corps, même avec les séquelles d’une trachéotomie se manifestant par le claquement du clapet d’une canule retentissant au rythme de son souffle et cassant un peu plus sa voix déjà détruite par l’alcool et les cigarettes. Devenue mondiale avec le succès de L’Amant, elle aspirait désormais à devenir éternelle.
La présence du corps
Indubitablement, l’écrit était le socle de son existence et de sa notoriété. Mais le sujet de l’écriture, c’était le corps, la présence du corps, mu par une marche inlassable, comme celui d’Anne-Marie Stretter avançant vers la mer, dans le delta du Gange ; ou le corps inerte, enfoui dans le sommeil, de la femme dans La Maladie de la mort, forme blanche dans la pénombre de la chambre ouverte sur la mer ; mais aussi le corps figé dans la fascination de Lol V. Stein allongée dans un champ de seigle scrutant, à travers une fenêtre, « ce spectacle inexistant, invisible, la lumière d’une chambre où d’autres sont »[1]. Et au-delà… cette affirmation énigmatique, surgie au cœur de l’été 1980 : « Je me suis dit qu’on écrivait toujours sur le corps mort du monde et, de même, sur le corps mort de l’amour »[2]. L’absence, la disparition, la mort ne suffisent pas à éteindre la présence.
Photographies
Dans sa maison et ses appartements, à Neauphle-Le-Château, à Trouville et rue Saint-Benoit, Duras maintenait la présence de ceux qui avaient toujours compté pour elle. Elle avait disposé sur les meubles d’anciennes photographies encadrées représentant son père peu avant son décès, alors qu’elle avait 5 ans, sa mère en Indochine, seule ou entourée par Marguerite et ses deux frères, son fils Jean quand il était enfant : « La photo sans laquelle on ne peut pas vivre, écrivait-elle, existait déjà dans ma jeunesse. Pour ma mère, la photo d’un enfant petit était sacrée. Pour revoir son enfant petit, on en passait par la photo ».[3]
Au milieu des portraits des siens, Marguerite Duras plaçait des clichés où elle-même posait, à tous les âges de sa vie : elle s’inscrivait ainsi dans une lignée, dans une histoire familiale mais aussi dans une coutume, populaire au XX° siècle, celle de la séance chez le photographe où on se tenait, « visage armé »[4], devant l’objectif pour célébrer un événement marquant, une étape dans l’existence. Ce qu’il y avait de « sacré » dans l’image émanait de la personne photographiée, de ce fond de l’être qui parfois transparaissait – à travers un regard, un port de tête, une attitude – et que l’appareil parvenait à saisir pour le fixer sur la plaque ou la pellicule photographique. De même, des éclats de vérité profonde que les mots tentaient d’exprimer en les inscrivant sur la page remontaient de « la chambre noire de l’écrit », ce creuset où Marguerite Duras situait la source de l’écriture.
Capter la vérité émanant de la profondeur du soi, c’était ce que Duras cherchait inlassablement à atteindre et à transmettre. Même si chaque tentative pour y parvenir aboutissait à une aporie : « On n’a jamais la photographie de soi, mais des photographies… Je voudrais qu’on fasse des photos de moi endormie ou en train d’écrire, car je pense que j’ai un visage différent dans ces moments où je suis au plus loin de moi-même. Mais ce n’est pas possible. Ça n’existe pas. Car je saurais toujours, au plus profond de moi-même qu’on est en train de me photographier, je le sentirais et je prendrais une pose pour la photographie. »[5]
Elle apparaissait donc « visage armé » sur chacune des images qui s’étaient accumulées depuis l’enfance, et qui toujours la décevaient car elles n’avaient capté que l’apparence, le masque que chacun présente aux autres, elle plus que tout autre, pour s’imposer, occuper l’espace, séduire, capturer, prendre et garder le contrôle, le pouvoir. Et l’absence de l’image absolue, celle qui aurait saisi le visage de la jeune fille de quinze ans et demi, sur le bac traversant le Mékong avant la rencontre avec l’amant, avait été à l’origine d’un livre. Car « c’est dans les états d’absence que l’écrit s’engouffre pour ne remplacer rien de ce qui avait été vécu ou supposé l’avoir été, mais pour en consigner le désert par lui laissé. » [6] Le roman de cette absence, L’Amant, l’avait rendue mondiale avec des millions de lecteurs, des traductions dans toutes les langues et une occupation de l’espace médiatique qui l’avait étourdie jusqu’à l’excès.
« L’histoire de ma vie, de votre vie, elle n’existe pas… »
Quant aux clichés photographiques, ils auraient du être rassemblés dans un album qu’elle aurait co-signé avec Jean Mascolo, son fils surnommé Outa, qui faisait profession de photographe. Elle le lui avait promis. Mais lorsque le texte s’était écrit, il était devenu L’Amant. Les images y avaient pris la seule place auxquelles elles pouvaient prétendre : celle de leur impossibilité à saisir l’absolu, la vérité des êtres et de leur vie. Elle avait définitivement abandonné les photographies à Outa, sans aucune légende. La réalité biographique qu’elles devaient permettre de documenter n’avait pour Duras aucun intérêt et sa mémoire ne tenait jamais compte de la chronologie. « L’histoire de ma vie, de votre vie, elle n’existe pas, ou bien alors il s’agit de lexicologie. Le roman de ma vie, de nos vies, oui, mais pas l’histoire. C’est dans la reprise des temps par l’imaginaire que le souffle est rendu à la vie. (…) Rien n’est vrai dans le réel, rien. »[7]
La matérialité des choses ne l’intéressait que lorsqu’elle pouvait les transmuer en mythes. Elle arrangeait bois flottés, galets et coquillages, lampes bricolées et cadres photographiques pour sacraliser son espace, son appartement de la rue Saint-Benoît, celui de Trouville et sa maison de Neauphle-le-Château, ces lieux de l’écrit tout autant que de la vie. Elle mettait en scène, elle architecturait sa présence au monde, y compris lorsqu’elle offrait son visage à l’objectif du photographe, mais ce n’était que l’apparence extérieure, le décor visible de la quête qu’elle persistait à mener en creusant au plus profond du soi, de « l’ombre interne », des peurs ancestrales et du silence. Elle y rejoignait ce qu’elle appelait « l’ensemble » pour « esquiver le nom de Dieu ». « Quelquefois, maintenant, je dis « Dieu », commentait-elle. Puisque le mot est là. Pratique. C’est un beau mot, court, ça change aussi. Je ne parle pas de Dieu, je parle du mot. Le mot est là, donc, pas par hasard. Les gens en avaient besoin. Pour désigner l’ensemble. »[8] C’est à ce niveau qu’elle se situait. C’est de là, qu’elle se sentait écrire et parler, jusqu’à son dernier souffle : « Je vais partir vers un autre degré. Nulle part »[9]…
Imposer sa présence à l’image
Alors, en 1990, à la fin de notre entretien, quand je lui avais demandé si elle pouvait me confier des photographies, indispensables pour illustrer pour le dossier du Magazine Littéraire, elle m’avait juste jeté : « Voyez avec mon fils, c’est lui qui s’occupe de ça ! » Et lorsque Jean Mascolo m’avait reçu dans son appartement de la rue Jacob et qu’il avait posé devant moi les boites contenant ces clichés dont la plupart demeuraient inédits six ans après la parution de L’Amant, j’avais été stupéfaite. Il ne s’agissait pas de boites de conservation avec papier cristal et onglets de séparation, comme dans les archives ou les bibliothèques, mais de boites à chaussures grand modèle contenant, en vrac, une masse de clichés de toutes tailles, aux bords parfois dentelés, certains protégés par une marie-louise cartonnée. Mais la plupart d’entre eux étaient traités comme de simples bouts de papiers sur lesquels était impressionnée, en noir et blanc, l’image de personnes disparues.
Le point commun entre elles, c’était elle, Marguerite Duras. Elle figurait sur presque toutes les photographies. Et sur chaque image, c’est elle qu’on remarquait. Même si elle n’était pas au centre du cadrage et pas uniquement parce qu’elle était la seule dont on connaissait le nom. Mais parce qu’elle l’avait voulu. Parce qu’elle l’avait cherché. À travers son corps et la relation de son corps à celui des autres, à travers sa capacité à occuper l’espace et à happer l’attention du photographe, elle manifestait son aspiration à une place prééminente. Cadette dans sa fratrie, petite par sa taille, longtemps desservie par de grosses et lourdes lunettes, elle transformait ce qui chez d’autres aurait été un handicap en outil de distinction. La tenue très simple qu’elle avait adoptée parce qu’elle était économique et pratique, parce qu’elle convenait à sa morphologie et à sa réputation d’intellectuelle – col roulé et gilet noir, jupe droite et courte, bottines à talons – elle l’avait intronisée « tenue d’écrivain » et l’avait imposée jusque dans les salons de réception de l’Elysée. Même Yves Saint-Laurent avait accepté d’en créer pour elle une version de luxe répondant à ces critères !
Au fil de l’écriture de cet article, des dizaines de portraits de Marguerite Duras sont apparus sur les murs du grenier de ma mémoire. Depuis 1990, et plus encore depuis sa mort, les trésors sont sortis des boites à chaussures. Ils ont été révélés dans des revues mais surtout dans de très beaux albums élégamment mis en page, certains signés ou co-signés par Jean Mascolo. On ne peut plus penser à elle sans la voir, à tous les âges de sa vie, belle jeune fille au chapeau déjà démodé, jeune femme bien habillée près d’une voiture de luxe, militante en parka à une réunion du Comité d’action étudiant-écrivain en 1968, auteure épanouie, aux lèvres finement maquillés et à l’élégant col roulé blanc devant les caméras d’Apostrophes : toutes ces visions d’elle-même qu’elle assumait et qu’elle avait contribué à forger. J’ai aussi entendu résonner sa voix de plus en plus rauque et saccadée au fil des ans, mais toujours affirmative, impérative, avec de brusques suspens, signes d’une interrogation, respectueux du silence. Pendant que j’écrivais, pendant que vous me lisiez, elle était présente et pas seulement par ses écrits. Par toutes les traces qu’elle a volontairement laissées, elle qui faisait œuvre de tout, afin de demeurer présente, inspirant les travaux de jeunes étudiants en art tout autant que d’écrivains confirmés, fascinant des lecteurs de tous âges ou provoquant leur détestation.
Et aujourd’hui ?
Parfois, en écoutant les informations du jour, je me prends à m’interroger : elle, qui prenait position sur tout, à contrepied souvent de ce qu’on attendait d’elle, contre qui jetterait-elle ce matin un anathème ? Que dirait-elle de notre monde, elle qui dans Le Camion, en 1977 déjà, lançait « Que le monde aille à sa perte, c’est la seule politique ! », puis commentait « Le monde est perdu. Ça n’a pas marché. C’est fini (et je l’espère). [….] Il faudrait une catastrophe qui égalise tout ça. L’hégémonie de l’Occident est terminée et, maintenant, le relais va être pris par des idéologies terrifiantes. ». Plus tard, devant Dominique Noguez, elle développait : « La perdition n’est pas la mort. C’est un brassement de population. C’est un même magma, c’est retourné à l’origine des choses. » Percevoir la perte du monde comme son malheur, sa mort, c’est une vision « de droite » : «« se perdre » signifierait alors « perdre de l’argent », « perdre son capital, son travail ». Non. La perte du monde, c’est que le monde se répande, c’est que l’égalité se répande, que le sort commun devienne vraiment commun. »[10]
Aliette Armel
[1] Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Gallimard, Folio, p. 63.
[2] Marguerite Duras, L’Été 80, Editions de Minuit, 1980, p. 67
[3] Marguerite Duras, La Vie matérielle, P.O.L., 1987, p. 99
[4] Marguerite Duras, La Vie matérielle, P.O.L., 1987, p. 100
[5] Le Bon plaisir de Marguerite Duras, France-Culture, 1984, réalisation Marianne Alphant
[6] Marguerite Duras, L’Été 80, Editions de Minuit, 1980, p. 67
[7] Entretien avec Hervé Le Masson, Le Nouvel Observateur, 28 septembre 1984.
[8] Entretien avec Dominique Noguez, in Œuvres cinématographiques. Edition vidéographique critique, 1984, p. 47.
[9] Marguerite Duras, C’est tout, POL, 1999.
[10] Entretien avec Dominique Noguez, in Œuvres cinématographiques. Edition vidéographique critique, 1984.
Partager cet article
Laisser un commentaire
Vous aimerez peut-être…
Pour être informé des dernières nouvelles,
abonnez-vous à la lettre d’info !
Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.