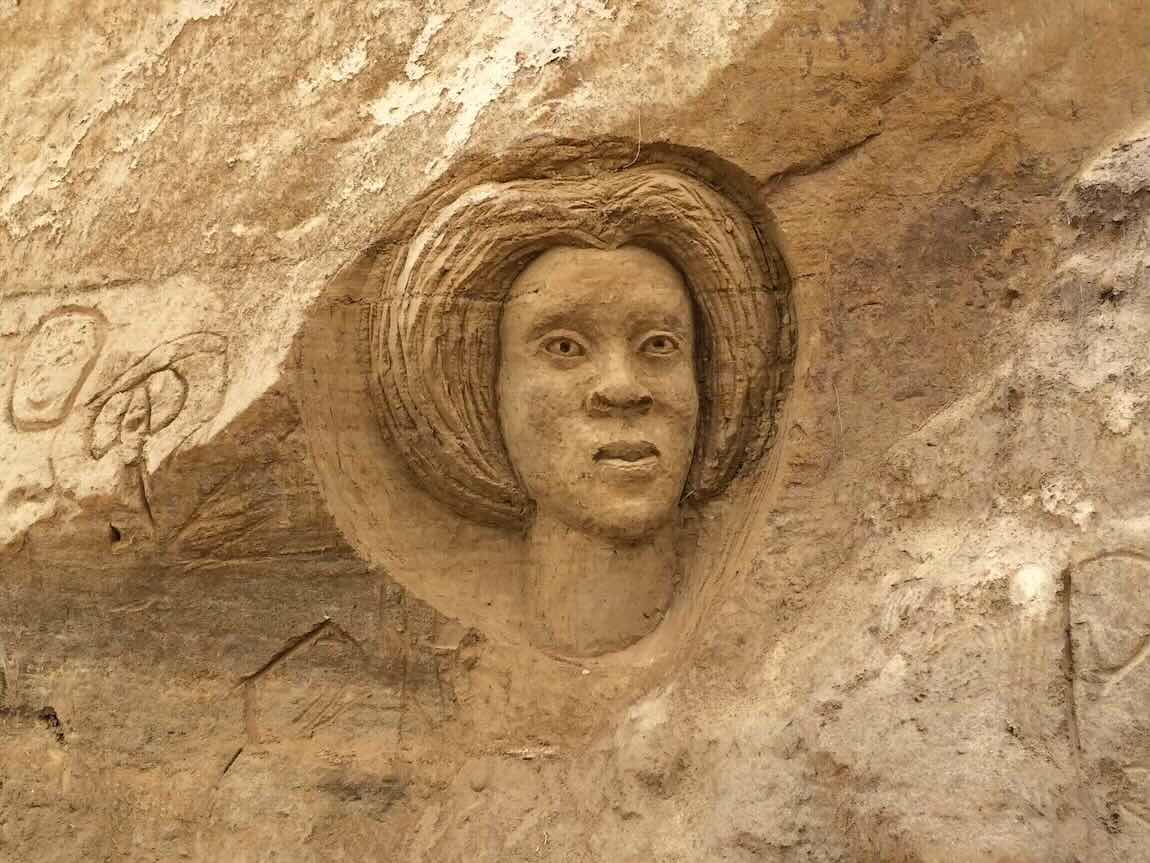La Mer de la tranquillité est le sixième roman de la jeune écrivaine canadienne Emily St. John Mandel, reconnue internationalement depuis Station Eleven, roman apocalyptique paru en 2014 et déjà annonciateur de la pandémie !
Transgresser les catégories littéraires
Transgresser les catégories littéraires
De combien de découvertes nous privons nous sous prétexte que « Non, merci vraiment, ça n’est pas mon genre ». Combien de fois les amateurs de romans dits littéraires, sérieux ou au contraire divertissants, ont-ils écarté de manière définitive et péremptoire une œuvre présentée dans un rayon étiqueté science-fiction ? « Vous n’y pensez pas ! La violence, le glauque, les aliens monstrueux et les robots destructeurs ? La vie est bien assez sinistre, les perspectives sur l’avenir de la Planète assez sombres. Je ne lis pas des romans pour ressasser le pire avant qu’il advienne. »
La Mer de la tranquillité de la canadienne Emily St. John Mandel figure certes au centre des vitrines des librairies de science-fiction. Mais ce roman prend aussi légitimement sa place aux côtés de chefs d’œuvre comme Le Patient anglais de son compatriote Michael Ondaatje ou comme Le Chant du bourreau de Norman Mailer, auteurs qu’Emily St. John Mandel cite comme ses sources d’inspiration.
Un voyage dans le Temps élargi de l’Histoire
Se situant au-delà des catégories, l’œuvre d’Emilie St John Mandel se joue aussi des époques avec une maestria confondante. Porté par une langue précise et claire, le flux de son récit traverse, de chapitre en chapitre, différentes périodes d’une Histoire aux limites repoussées jusqu’à 2401 et il entrecroise le destin de personnages attachants, d’une grande richesse humaine. Le lecteur est emporté sans efforts dans un voyage où le temps suspend parfois son cours pour dévoiler une faille spatio-temporelle, une anomalie mettant en danger la cohésion de l’univers sur laquelle veille l’Institut du Temps, créé en 2203 sur une colonie lunaire.
Certes on pressent que le gouvernement dont les bâtiments jouxtent ceux de l’Institut du Temps n’est pas très démocratique. Mais ses chercheurs peuvent toujours poser des questions fondamentales, et envisager leurs implications éthiques : le monde n’est-il qu’une simulation ? Certes les bouleversements climatiques ont rendu inhabitable une partie de la Terre et ont contraint certains survivants à émigrer dans les colonies lunaires, Les architectes y ont couvert les ensembles résidentiels d’un dôme simulant un ciel, avec des alternances de bleu parcouru de nuages et de noir sombre de nuit, au rythme d’un éclairage programmé pour créer l’illusion du lever et du coucher de soleil. Même dans la Cité de la nuit où ce système s’est détraqué et le noir permanent, les habitants ne jouent pas qu’avec des hologrammes. Ils échangent, s’interrogent sur leur avenir dans cette atmosphère artificielle où la fluctuation des vagues à la surface des océans n’est plus qu’un vague souvenir. Ils demeurent profondément humains.
Et lorsqu’en 2401, Gaspéry, un des voyageurs du temps envoyé par l’Institut vers Caiette sur l’île de Vancouver, se retrouve sur les bords du Pacifique (en 1912 puis en 1994), son émotion est vive, sa perception des éléments naturels qui l’entourent aigue et il l’exprime avec une poésie qu’accentue la remontée du souvenir de sa mère : elle a vécu, elle, sa jeunesse sur Terre.
« Le chaos ne durerait pas éternellement. Les gens s’organiseraient pour, à moyen terme, renouer avec la paix et la stabilité. » Emily St. John Mandel
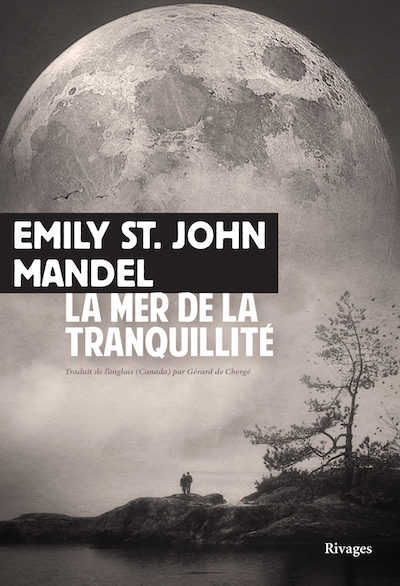
Une étrange normalité, une possible douceur, aux bords d’une mer de tranquillité
Cette planète Terre est demeurée peuplée et active. Elle accueille toujours des activités culturelles. C’est ainsi qu’à la veille d’une nouvelle pandémie, Olive Llewellyn se retrouve en 2203 à six heures d’aéronef de la colonie lunaire où vit sa famille : elle va de ville en ville pour promouvoir son dernier ouvrage, Marienbad, roman post-apocalyptique au succès planétaire, car considéré comme visionnaire, à l’image de Station Eleven, le roman d’Emily St. John Mandel qui, dès 2014, annonçait la pandémie. Cette dimension autobiographique accentue la douceur, parfois l’inquiétude, mais aussi la joie qui s’exprime dans les passages où sont décrites les relations entre Olive, sa fille et son mari, tout au long d’un interminable confinement. Emilie St. John Mandel nous réconcilie ainsi avec les possibilités d’un futur que n’épargnent ni les pandémies ni la tyrannie.
Elle s’appuie sur des découvertes scientifiques et techniques avérées pour construire un univers certes imaginaire mais qui apparait à son lecteur comme plausible, humainement viable et parfois étrangement familier. Sans doute y-a-t-il déjà abordé en rêve ? Ce monde est empreint de menaces et de bouleversements certes, mais aussi porteur de la tranquillité qui a donné son nom à la plaine de basalte, dépourvue d’eau mais dénommée « mer », sur laquelle s’est posée, en 1969, l’Eagle d’Apollo 11. Les astronautes qui en sont sortis, ont alors accompli « Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité ».
Références
- Emily St. John Mandel, La mer de la tranquillité, trad. par Gérard de Chergé, Éd. Rivages, 2023.
Partager cet article
Laisser un commentaire
Vous aimerez peut-être…
Pour être informé des dernières nouvelles,
abonnez-vous à la lettre d’info !
Une fois par mois, découvrez l’actualité des ateliers d’écriture, mes nouvelles publications de ressources et les nouveautés de mon journal de bord.